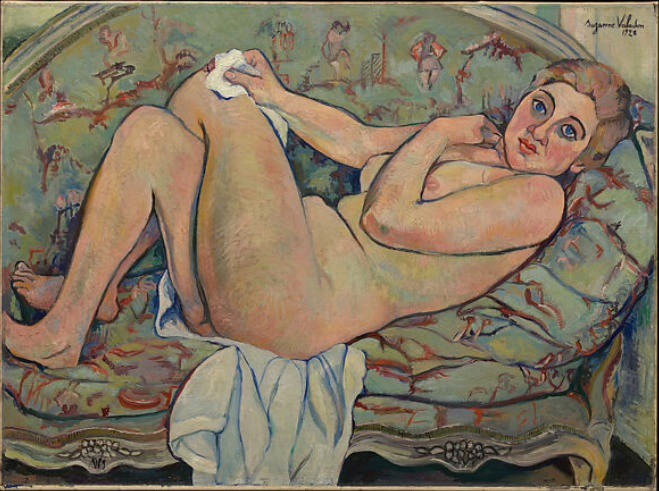Je fais une petite caresse sur le rabat qui couvre le clavier de mon cheval, en signe de reconnaissance et d’affection. Je n’ai pas repiqué aux séances de vélo d’appartement, une seule m’a guéri. Le cheval prend soin de moi beaucoup mieux, comme je prends soin de lui, même s’il est complètement artificiel, sans une vraie corde métallique en lui, ni un seul marteau, juste avec du bois d’apparat, mais très beau, noir luisant, tiède et presque soyeux comme je le sens sous la tape caressante de ma main.
J’ai baissé ce matin le curseur de son potentiomètre de décibels si bien qu’il chantonnait plus à l’aise le Jésus que ma joie demeure, reprenait patiemment à chacune de mes demandes et nous ne gênions pas les voisins. Fenêtres ouvertes, les cris des martinets nous ont accompagnés.
Les liens sensoriels, affectifs, coopératifs et de tous ordres, qui nous attachent l’un à l’autre, les uns aux autres devrais-je dire, donnent à tout cet ensemble (piano, martinets, voisins, habitants occasionnels qui me rendent visite, celles et ceux qui m’écoutent ou me parlent à la faveur des ondes, des pages internet, des livres, du flot de la rue comme de celui de la rivière) une véritable proximité bienveillante. Il n’y a aucune solitude possible dans le travail, pas plus que dans la vie, il y a de l’entraide avant tout — ou, devrait-on dire, de la présence sécurisante. Ce sont là les conditions de la vie.
La guerre existe. Parlez de moi, dit-elle en entrouvrant la porte de cette maison de mots. Mais personne ne lui répond.