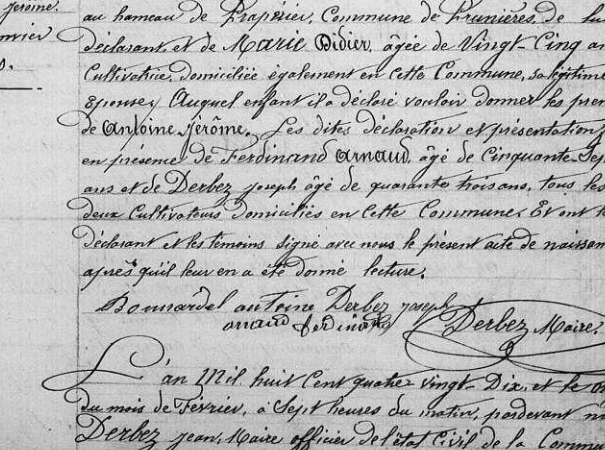Monsieur Nuit sait qu’il est le roi. Une sorte de roi très démodé, sans couronne ni royaume, sans prestige. Sans aucun pouvoir non plus, mais il règne sur le langage. Il est comme une mère oiseau qui couve tous ces œufs que sont les mots de toutes les langues. Il glisse à la surface de cette eau comme cette mère l’Oie sur la rivière, année après année, qui escorte les générations de jeunes canards et sans doute leur transmet ce fluide de conteuse qui les retient près d’elle, obéissants, attachés bien au-delà de l’âge de raison. Comme elle, monsieur Nuit possède le charme de l’inconnu d’un pays étranger.
Mais les petits humains ne sont pas des canards sauvages, ils quittent l’enfance sans avoir pu courir derrière monsieur Nuit — sauf exception, bien sûr, j’ai déjà raconté mon escapade de tout petit garçon vers le soleil couchant derrière cet homme à la charrette que j’avais pris pour mon oncle… ce qui m’avait valu une bonne correction lorsqu’il avait retrouvé la maison où m’attendait ma mère.
Mais le langage avait lâché son emprise. J’avais voyagé entre des fleurs géantes qui chantaient la baignade du soleil glissant dans les marais.
Lorsque j’ai trouvé ce vieux roi suranné, devenu presque aussi vieux que lui, je me suis presque confondu avec ce mélange de terre et d’eau et de soleil, presque.