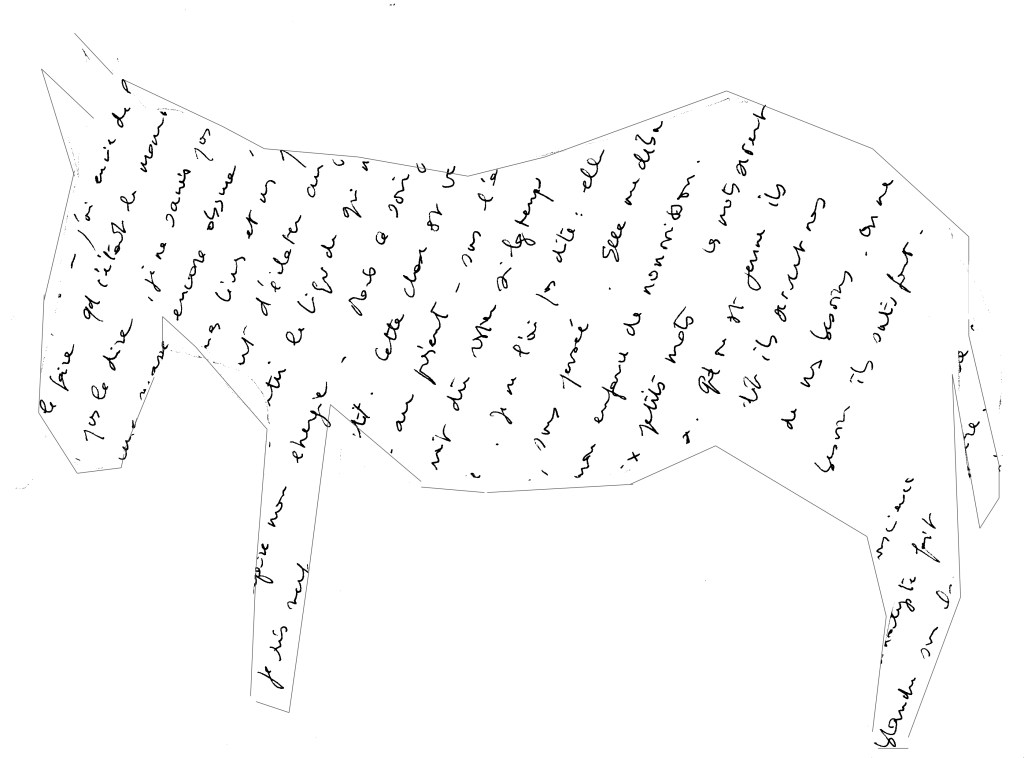Monsieur Nuit glisse la tête derrière mon épaule, alors que je suis en train de peindre : Même le beau n’est pas beau.
Il me laisse avec cette constatation un peu sarcastique, un peu édifiante, il se retire comme un serpent dans son trou. Il est temps pour moi de descendre marcher. L’après-midi d’automne est courte.
A la porte le romarin, ensoleillé. Que tu es beau !
Je comprends tout de suite. Dans le dialogue qui vient de s’ouvrir je suis déjà, plus vite même que de franchir le seuil, présent, adopté.
Et bientôt, marchant dans une allée sous les arbres, les pieds dans les feuilles de toutes couleurs, qui rient, sourient, plus belles, décoratives, ravies, rouges, jaunes, brunes, ocres, orangées, que des visages enjoués, des grands cils, des mèches folles, des paupières d’or, des pommettes fardées, toute cette foule à mes pieds qui éclate d’une joie surnaturelle !
Monsieur Nuit sort d’une poche que je ne savais pas avoir dans mon dos.
Il se hisse sur mon épaule comme il aime le faire. Je devine qu’il vient profiter du spectacle.
Rien à dire ! Nous sommes bien tombés !
On marche dans les étoiles.
On patauge, tu peux dire.
Monsieur Nuit a toujours le mot pour rire.
Il se renfrogne quand les choses ne sont pas drôles. Se rétracte et disparaît. Comme un vieillard.
Monsieur Nuit connaît bien sa nuit. C’est pourquoi il ne patauge pas dans la peinture, ni sur le piano, ni sur la feuille de papier. Mais ça ne l’empêche pas d’être un vieil impotent.
Peinture de Bato Dugarzhapov, Studio, 1999