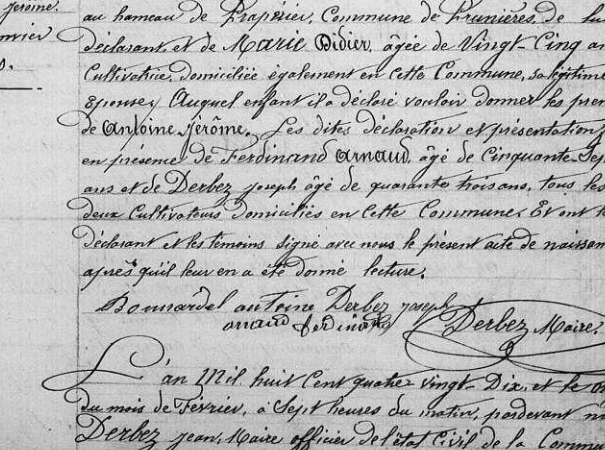Le hasard devient nécessité.
Je suis resté plusieurs minutes tout près de l’oiseau. Je la regardais, je l’écoutais — une merlette, le bombé bicolore gris orangé des petites touches de sa poitrine —, son œil petit rond qui me voyait, sa douce lenteur presque immobilité qui vivait un autre rythme que le mien, tout près et auquel je tentais de m’habituer. Puis elle faisait quelques pas coulés sautillés mais restait à distance de main, à mes pieds, sans aucune méfiance, se retournait, piquait avec vivacité quelque filament dans l’épaisseur feuillue du sol en décomposition, même pas un ver, me sembla-t-il, quelque infime fluide ou matière pour son bec. Nous avons ainsi partagé la délicatesse d’un long patient moment de vie respirée, goûtée ensemble. Elle a glissé se fondre un peu en retrait de ma vue, dans l’ombre, tandis que je me remis en marche, sans heurt, sans un bruit, sur le sentier de la rive. Elle, moi, nous étions le hasard — le présent — devenu nécessité — ce qui ne peut plus ne pas être — devenus porteurs de temps, temps emporté. Ce temps né de rien qui lui-même nous a faits et nous transforme sensiblement en permanence.
De retour à ma table, je fais se rencontrer les couleurs — hasard mêlé de nécessité, mon regard cherche à les voir danser l’un avec l’autre.